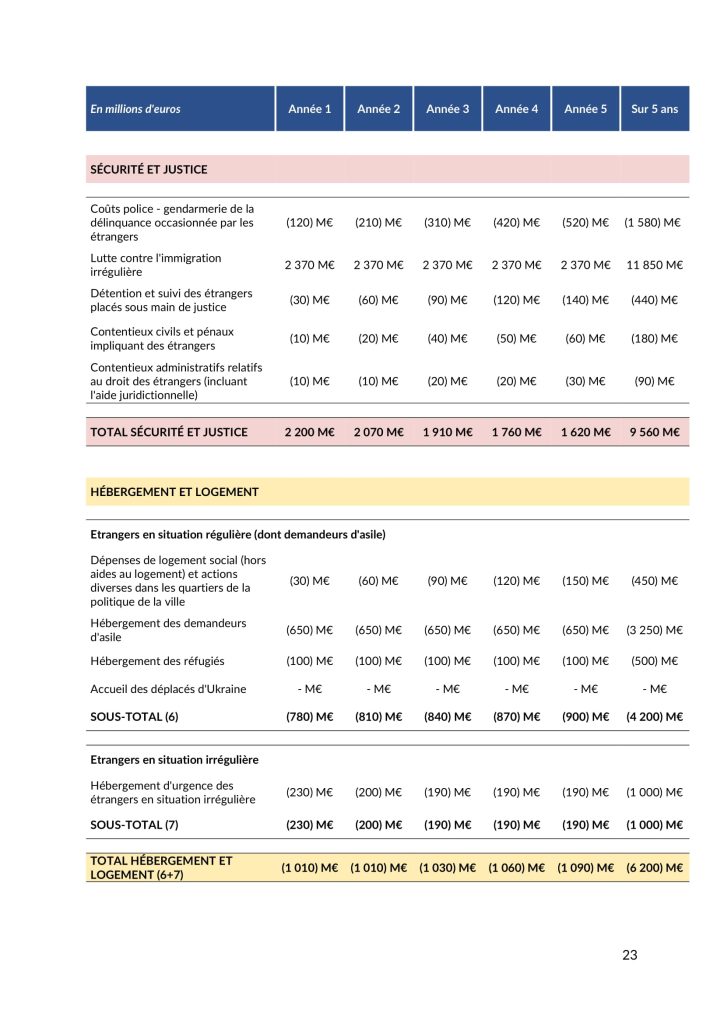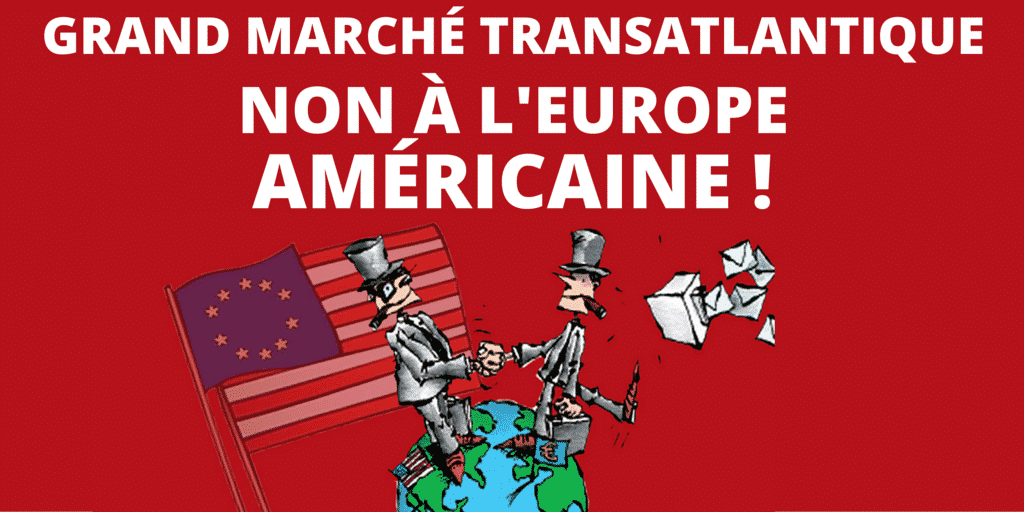### Immigration et la Fiction des Charges Sociales
Le 29 juin 2024, le sujet du coût de l’immigration pour les systèmes sociaux continue d’alimenter un débat souvent entaché de fausses informations. Une critique récente accuse Éric Zemmour de propager une fausse narration selon laquelle les immigrants seraient des charges insupportables pour les finances publiques et la sécurité sociale. Cependant, l’analyse approfondie des données disponibles met en évidence que ces préoccupations sont largement infondées.
Depuis plusieurs années, divers rapports internationaux ont mis en lumière le fait que non seulement les immigrants ne représentent pas un fardeau pour la sécurité sociale et les finances publiques, mais qu’ils contribuent même de manière positive. Par exemple, une étude canadienne a montré qu’un immigrant moyen apporte entre 35 000 et 45 000 dollars au trésor public tout au long de sa vie, ce qui constitue un investissement avantageux pour la société.
En Europe, l’OCDE s’est également penchée sur cette question. Selon leurs recherches, le coût de l’immigration n’excède jamais 0,5 % du PIB, soit un impact extrêmement limité tant en termes positifs qu’en termes négatifs. Les différences observées entre les pays sont attribuables à des disparités démographiques et socio-économiques plutôt qu’à une quelconque responsabilité particulière de l’immigration.
En France, le CEPII a étudié la contribution économique des immigrés sur un périmètre de trente ans. Selon ces travaux, les immigrés n’ont jamais été à l’origine du déficit budgétaire français, malgré leur position souvent moins favorable en termes d’impôts et cotisations. Cette analyse met en évidence deux facteurs importants : une population généralement plus jeune (et donc plus active), contribuant davantage aux impôts et cotisations, et des salaires moindres qui limitent les contributions fiscales.
Par ailleurs, l’impact positif de l’immigration sur le PIB par habitant est bien documenté. Une étude française de 2015 indique qu’un taux d’immigration supplémentaire de 1% entraîne une augmentation du PIB par habitant de 0,3978%. Cette tendance reflète également la situation en Belgique où l’économie se montre favorable aux flux migratoires.
Lorsque l’on aborde spécifiquement le cas des caisses de retraite et de la sécurité sociale, les preuves concordent : les immigrants ont un impact positif sur ces systèmes, principalement en raison de leur jeunesse relative par rapport à la population générale. En conséquence, ils contribuent moins aux dépenses liées au vieillissement.
En outre, l’étude montre que le débat autour du « coût d’élevage » des immigrants est une autre source de confusion. Le véritable coût économique réside dans les investissements faits par les pays d’origine pour former ces travailleurs avant qu’ils ne migrent vers les pays développés. Ce phénomène, exacerbé par la mondialisation et les politiques néolibérales qui ont privé les pays en développement de leurs ressources humaines qualifiées, souligne l’injustice économique sous-jacente.
La France a même mis en place une carte de séjour spéciale pour attirer des talents étrangers. Cependant, ces initiatives soulignent également le problème du « pillage des cerveaux » par les pays développés, qui bénéficient d’une main-d’œuvre formée à moindre coût.
En conclusion, la thèse selon laquelle l’immigration serait une charge pour les finances publiques et la sécurité sociale est largement infondée. Les immigrants apportent en réalité un équilibre financier positif, contribuant au PIB et aux cotisations sociales tout en soulageant le système de retraite par leur jeunesse relative.