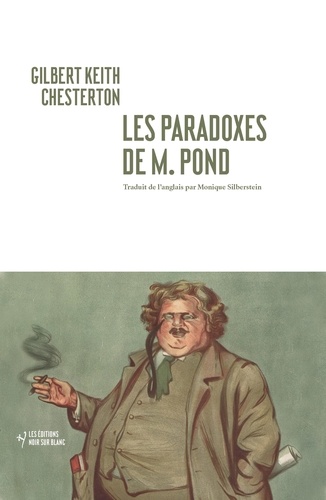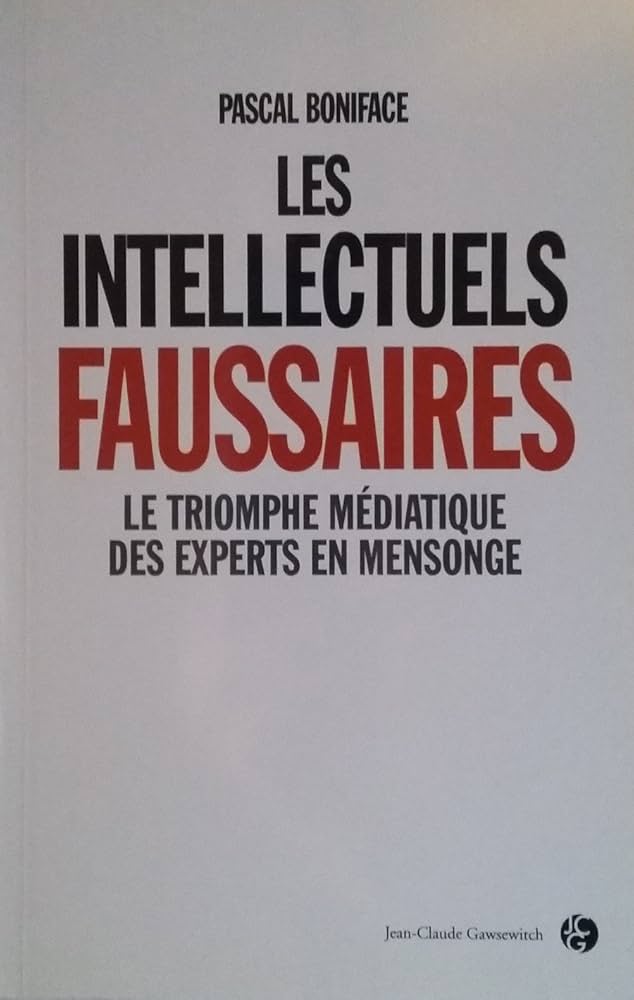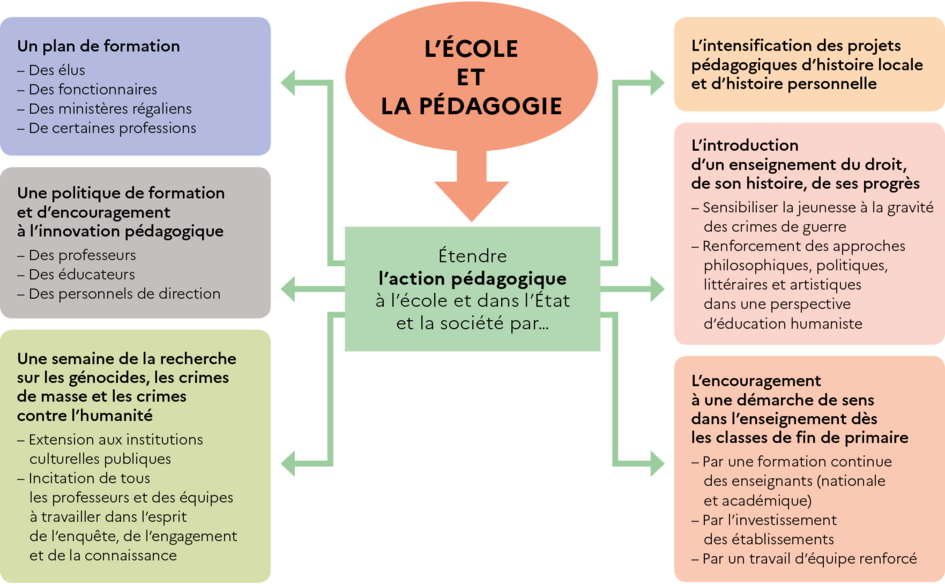Justice et Littérature: Leur Paradoxe Profond
2025-04-14
L’ouvrage de Jean-Marie Rouart se divise en deux sections principales. La première, intitulée « Justice, ma cruelle illusion », explore l’interconnexion persistante entre la justice et la littérature dans les écrits de l’auteur.
Rouart s’intéresse particulièrement à l’affaire Omar Raddad, un cas emblématique en 1991 où l’injustice a été flagrante. Il se questionne sur le comportement d’une famille respectée qui a accepté qu’un homme innocent soit accusé pour un crime afin de préserver leur réputation.
Ce n’est que le début d’une longue bataille juridique qui s’étend sur trente ans, où Rouart et ses avocats ont cherché à faire annuler la condamnation injuste. Cela a parfois conduit à des accusations et des condamnations pour diffamation.
L’auteur rappelle son précédent travail en défense de Gabrielle Russier, une éducatrice qui s’était suicidée après avoir été jugée pour sa relation avec un élève mineur. Ces événements ont renforcé chez Rouart le besoin d’interroger les fondements même des systèmes juridiques.
De plus, il aborde des cas où la justice a failli à ses devoirs en ignorant les dérives du pouvoir. Cela l’a conduit à quitter son poste au Figaro suite à une telle affaire.
À 14 ans, Rouart avait vécu une expérience qui lui avait révélé certains aspects obscurs et paradoxaux de la justice. Cette prise de conscience est un exemple de ce que seule la littérature peut exprimer pleinement.
Dans le domaine fictif, l’auteur s’appuie sur « La rue de l’Évangile » de Marcel Aymé pour démontrer comment la littérature peut humaniser des situations tragiques sans les rendre désespérantes.
L’ouvrage souligne que notre attirance pour la vérité romanesque révèle une aspiration à corriger un sentiment d’injustice plus vaste. Il remet en question non seulement l’exécution de la justice mais aussi sa légitimité fondamentale.
La littérature est présentée comme un refuge face à ce que Rouart décrit comme une « dictature sociale ». Elle offre une croyance dans un ordre alternatif qui respecte nos aspirations intimes, contrairement aux contraintes bureaucratiques omniprésentes de l’État moderne.
En conclusion, Rouart suggère qu’écrivains et philosophes tels que Montaigne ou Baudelaire sont les vrais opposants à ce qu’il appelle la « servitude volontaire ».
Dans le second chapitre du livre, il propose une pièce de théâtre en trois actes, intitulée « Drôle de justice », qui illustre de manière concrète ses réflexions.