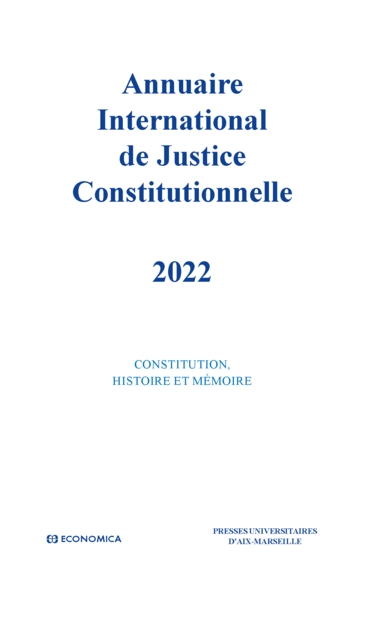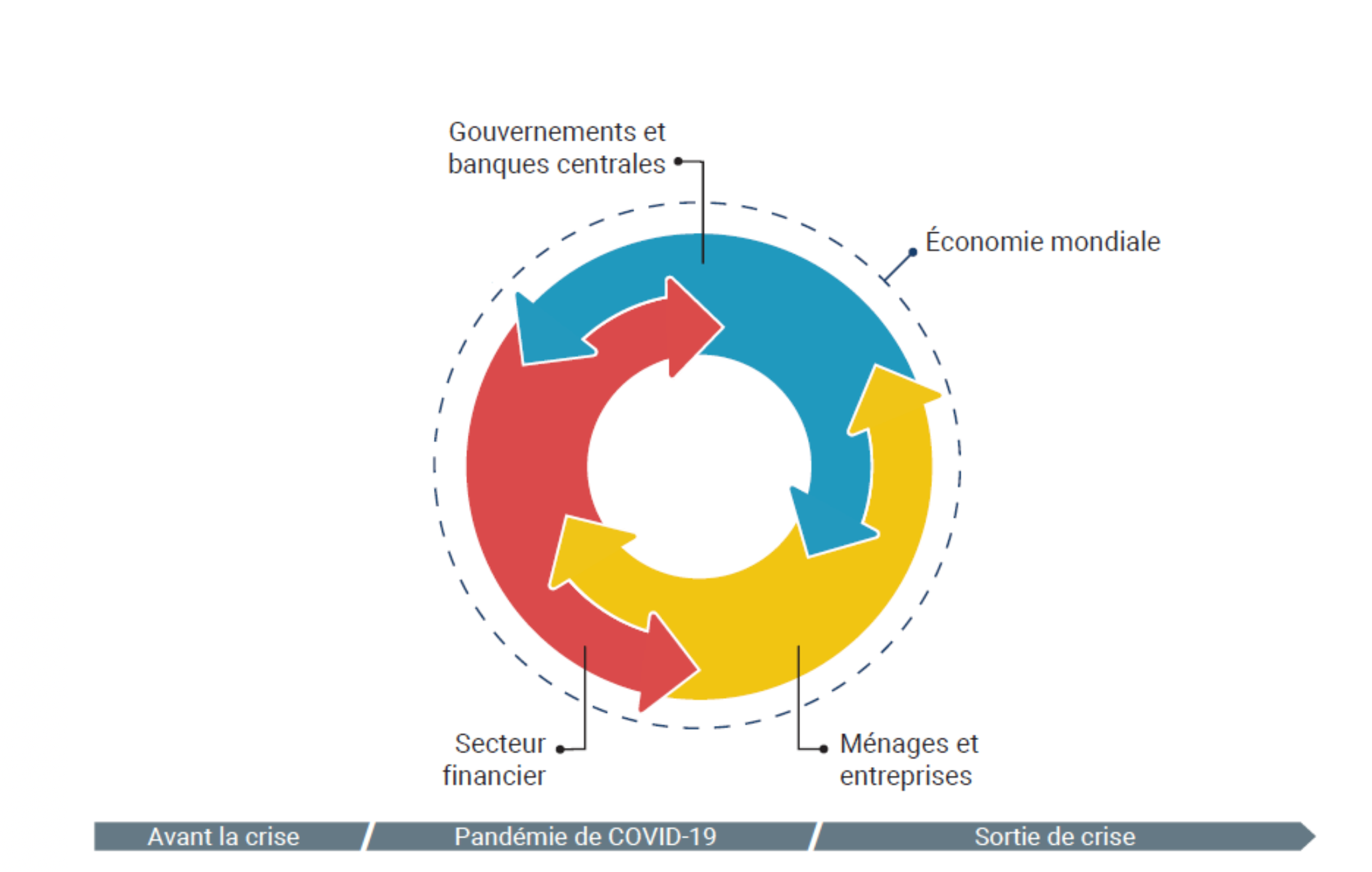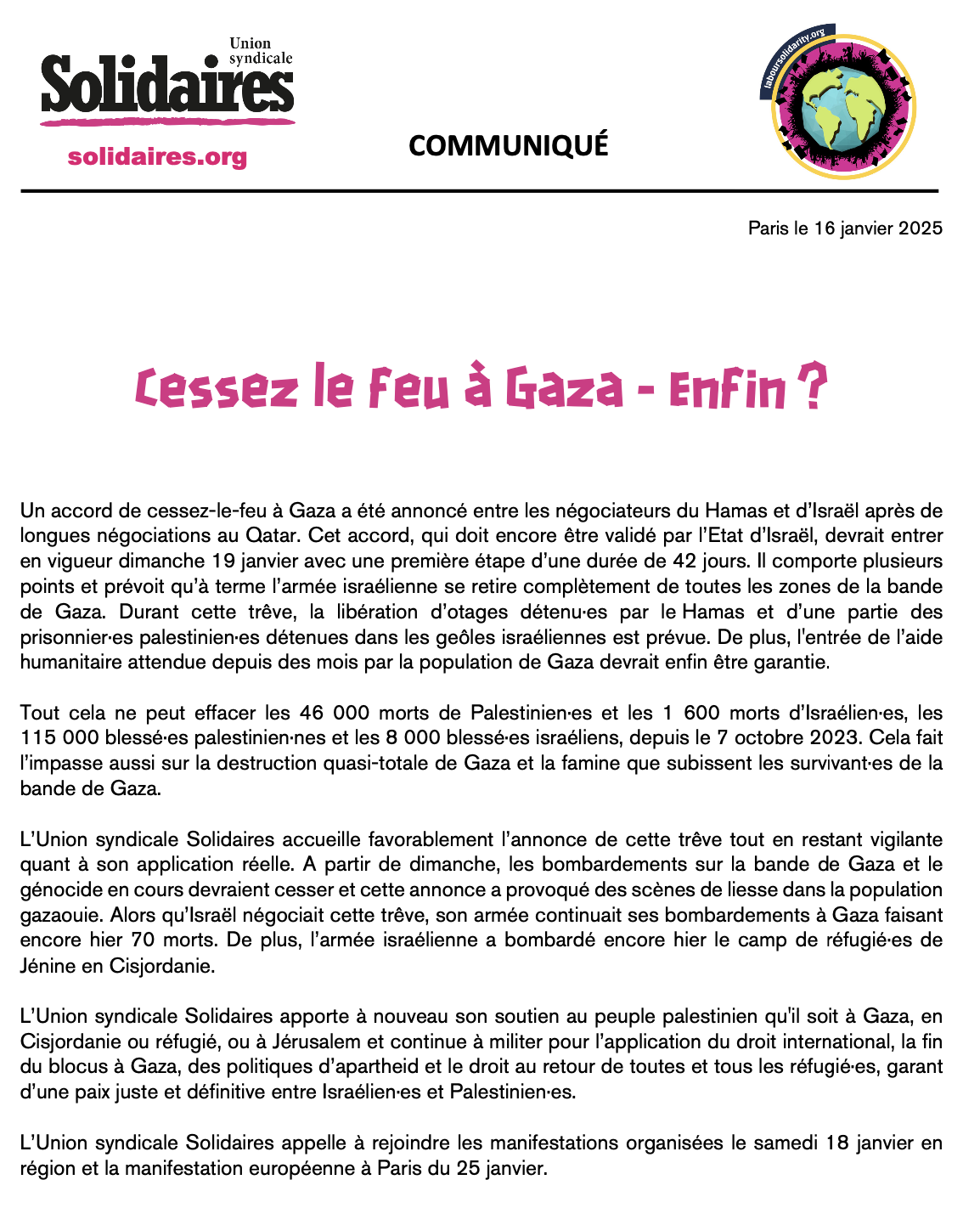Titre : La Négation du Génocide par des Académiques : Une Réflexion Critique sur le Débat Historique
Raz Segal, historien israélien basé aux États-Unis, partage son expérience troublante en tant que juif controversé qui ose critiquer les actions israéliennes à Gaza. En tant que professeur d’études sur l’Holocauste et le génocide à l’Université de Stockton, il examine les mécanismes de déni qui émergent autour du génocide en cours contre les Palestiniens.
Les interrogations sur le soutien inconditionnel de l’Allemagne à Israël, surtout durant les récents conflits, soulèvent des questions sur les relations historiques qui relient colonisation israélienne et génocide. Le cessez-le-feu actuel ne met pas fin aux violences, encore visibles en Cisjordanie, où des attaques israéliennes continuent de provoquer des pertes humaines, illustrant la Nakba qui persiste au-delà des accords temporaires.
Un événement en ligne organisé par le Western Galilee College, le 19 décembre 2024, a vu des chercheurs israéliens et allemands remettre en question les universitaires qui osent évoquer le terme « génocide » en relation avec Gaza. En dépit d’un hommage rendu à l’historien Yehuda Bauer, les discussions ont largement omis la considérable preuve du génocide, choisissant une forme de déni.
L’historienne Verena Buser a minimisé les affirmations concernant le nombre de victimes palestiniennes, ignorant le consensus international qui chiffre le nombre de morts à plus de 46 000. D’autres études récentes évoquent des pertes encore plus importantes, notamment un grand nombre d’enfants. Buser a même suggéré que la famine à Gaza pourrait être le résultat de défis logistiques en temps de guerre, sans fournir d’évidence tangible pour soutenir sa déclaration.
Les critiques d’universitaires juifs se heurtent souvent à des accusations d’antisémitisme, une réaction qui semble nier la diversité des voix juives face à la tragédie palestinienne. Cette dynamique semble garantir une vision manichéenne qui ignore les variétés d’identités dans la communauté juive.
L’historien Dan Michman, à la tête d’un institut de recherche sur l’Holocauste, a même fait référence à Hitler pour soutenir ses argumentations, tentant de lier antisionisme et antisémitisme de manière fallacieuse, et négligeant l’importance des voix juives critiques envers le sionisme.
Les travaux d’experts reconnus en droit international, tels que William Schabas, ont décrit la brutalité des actions israéliennes à Gaza comme susceptibles d’être qualifiées de génocide. La réaction à ces idées reste néanmoins divisée, certains chercheurs se refusant à considérer ce qualificatif.
La dynamique de ce débat ne se limite pas à une simple appréciation académique des événements ; elle reflète également des luttes de pouvoir sur l’héritage de l’Holocauste. Pour beaucoup en Allemagne, le soutien à Israël est perçu comme une forme de réparation pour les atrocités passées. Cependant, cette notion de « l’unicité de l’Holocauste » complexe demande également une interrogation sur la responsabilité en cours et sur la continuité des politiques de colonisation.
À la lumière de ces discussions, il devient primordial que le discours sur l’Holocauste et le génocide contemporain soit ancré dans une réalité qui refuse la hiérarchisation des souffrances, promouvant au contraire un dialogue sincère qui reconnait la douleur et le droit à la vie de tous les peuples.