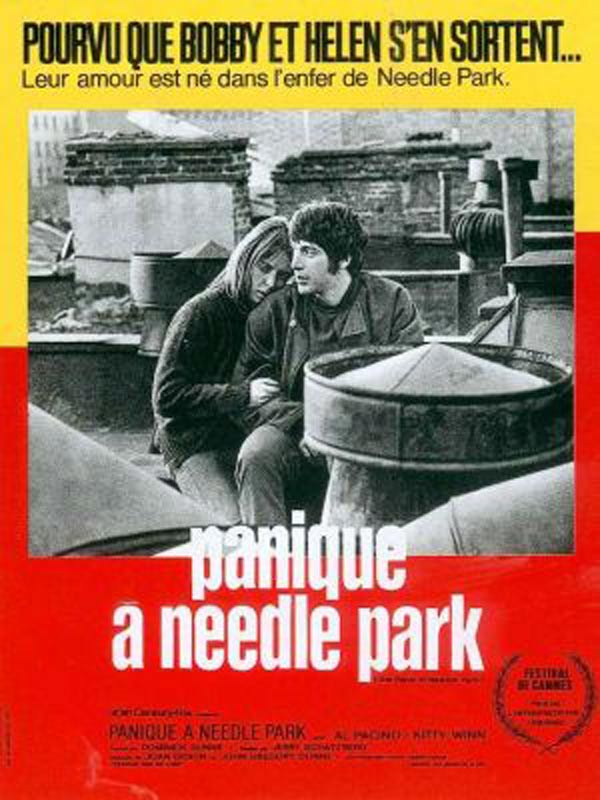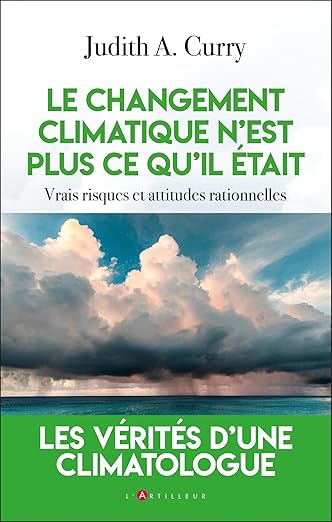### Titre : Le retour du Needle Park : entre tolérance et crise
Depuis mon installation dans le canton de Vaud, une réalité m’interpelle : la banalisation du trafic de drogue. Dans les gares et sur les passerelles, des dealers opèrent ouvertement, attendant leurs clients sans crainte. La réaction des municipalités reste préoccupante, car elles choisissent de « contenir » cet enjeu plutôt que de l’affronter.
La Suisse a déjà vécu des moments similaires dans les années 1980 et 1990 avec la plage de la Platzspitz à Zurich, devenue un lieu de rencontre pour les toxicomanes, entraînant un désastre sanitaire avec des taux alarmants de VIH et d’hépatite, ainsi que des overdoses fréquentes.
Pour répondre à ce désastre, le gouvernement suisse avait mis en place une stratégie fondée sur quatre axes : prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Cette approche a permis de stabiliser la situation à l’époque en limitant les risques liés à la consommation et à la vente de drogue.
Malheureusement, cette stratégie semble aujourd’hui oubliée. La prévention était censée éduquer le public, notamment les jeunes, sur les dangers des drogues. Les traitements incluaient l’accès à la méthadone pour les héroïnomanes et à des centres de désintoxication. La réduction des risques visait à créer des espaces de consommation encadrés pour limiter la propagation des maladies. Enfin, la répression tentait de cibler les trafiquants tout en évitant de pénaliser les consommateurs.
Aujourd’hui, la montée préoccupante du crack a incité une lente réaction des autorités, malgré les leçons de l’histoire. La crise de l’héroïne à Berlin dans les années 1970, due à une inaction gouvernementale, a démontré à quel point le laxisme peut avoir des conséquences désastreuses, conduisant à une montée de la violence et à la stigmatisation des usagers.
Le constat actuel en Suisse est alarmant : le trafic prospère, les niveaux d’insécurité augmentent et l’influence des réseaux criminels se renforce. Les municipalités, souvent dirigées par des partis de gauche, semblent réticentes à adopter une approche plus stricte.
Sous le prétexte de maintenir un lien avec les toxicomanes pour faciliter leur prise en charge, elles permettent au trafic de se développer. De plus, certains dealers sont affiliés à des organisations criminelles, profitant des failles du système.
Plutôt que d’expulser ces trafiquants, certaines villes envisagent même une distribution contrôlée de cocaïne, inspirée des mesures passées pour l’héroïne. Cependant, cette stratégie ne résout pas le véritable problème : le contrôle des marchés illicites par des réseaux mafieux. Pendant ce temps, les jeunes risquent d’être exploités, y compris par le biais d’échanges de services sexuels contre de la drogue, et les infrastructures de santé deviennent saturées.
Il est urgent de tirer les enseignements du passé. La stratégie des quatre piliers a réussi parce qu’elle alliait soutien et fermeté. Aujourd’hui, le volet répressif est largement négligé, au nom d’une idéologie mal comprise.
Sans une action claire contre les réseaux criminels et un retour à une répression efficace du trafic, la Suisse risque de revivre les tragédies du passé, avec des répercussions humaines et sociales catastrophiques. Les autorités doivent agir avant qu’il ne soit trop tard pour prévenir une nouvelle crise comme celle de la Platzspitz.